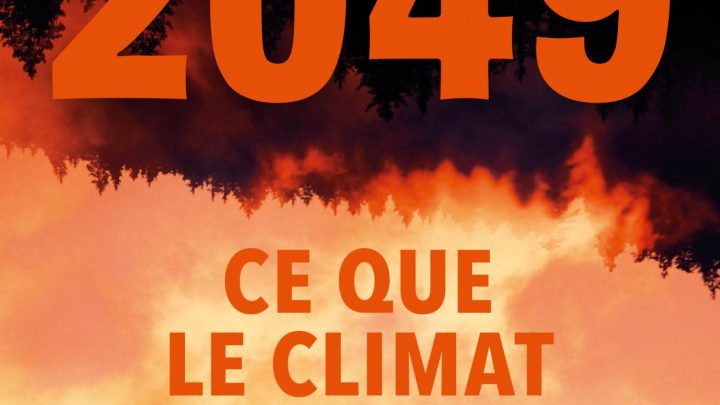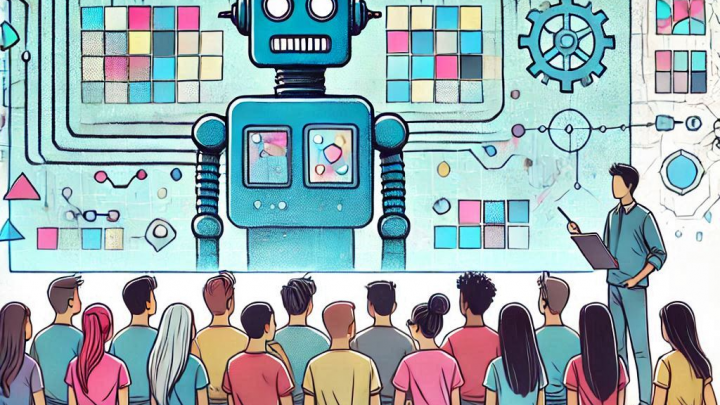Publié le 29 janvier 2025 Pourquoi si peu de transparence concernant les pesticides ? Elisabeth Lambert, Nantes Université; Karine Favro, Université de Haute-Alsace (UHA) et Quentin Chancé, Centre national de la recherche scientifique (CNRS) La moitié des fruits cultivés en France comporte au moins un pesticide potentiellement dangereux. Derrière les enjeux de transparence sur ces produits et leur utilisation, on retrouve des obstacles de nature légale, administrative, technique et sociale. Des voies d’amélioration sont toutefois possibles, du champ jusqu’à l’assiette, pour le riverain d’exploitation agricole comme pour le consommateur. La moitié des fruits et le quart des légumes cultivés en France conservent, lorsqu’ils sont consommés, au moins un pesticide cancérigène, ou bien susceptible de provoquer des mutations de l’ADN, ou encore d’affecter la reproduction. Une réalité qui préoccupe, d’où la demande de plus de transparence. Pourquoi est-ce important ? Tout d’abord, car la transparence permet de garantir la responsabilité des acteurs en cas d’atteintes à la santé et à l’environnement ; ensuite, car elle favorise la confiance du public à l’égard des autorités régulatrices et des entreprises agricoles en démontrant leur engagement envers la sécurité et la durabilité. Enfin, la transparence facilite la surveillance et l’évaluation des risques, en permettant aux chercheurs et aux experts de disposer de données fiables et accessibles pour étudier leurs effets à long terme. Mais entre la théorie et la pratique, on trouve un monde, des obstacles de nature légale, administrative, informatique, ainsi que des barrières techniques, politiques et sociétales, et des questionnements sur la façon de rendre une information pertinente et claire. Malgré tout cela, plus de transparence est encore possible, et ce, du champ jusqu’à l’assiette, pour le riverain d’exploitation agricole comme pour le consommateur. Voici comment. Informer le grand public des usages des pesticides Les questionnements autour des pesticides débutent souvent lors de leur épandage par un agriculteur. Aujourd’hui, le partage des informations disponibles à ce sujet reste très laborieux : lors d’une commission d’enquête sur les « plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires sur la santé humaine et environnementale » en 2023, le député PS Dominique Potier qualifiait la recherche d’information d’« ubuesque ». Les limites sont ici avant tout réglementaires et techniques. En effet, les agriculteurs doivent répertorier, depuis 2009, leurs usages de pesticides (produits, quantités, sites d’épandage) dans des « cahiers de culture », mais ces derniers ne sont accessibles et mobilisables par les pouvoirs publics qu’en cas de contrôle (5 % à 7 % des fermes par an). Le 14 janvier 2025, le premier ministre souhaitait malgré tout voir réduire ce nombre. Un Règlement européen d’exécution du 10 mars 2023 pourrait cependant aider à plus de transparence, puisqu’il imposera l’obligation, en 2026, de numériser et harmoniser ces registres afin de faciliter la connaissance scientifique en matière de santé environnementale. Cette question de l’harmonisation est loin d’être anodine, car, en pratique, les filières agricoles disposent déjà de registres d’usage de pesticides via les systèmes de traçabilité internes des coopératives, des groupements industriels et de producteurs, lesquels rassemblent le contenu des cahiers de cultures. Mais détenues par de multiples acteurs via des logiciels différents, ces bases de données ne sont pas « informatiquement » compatibles entre elles. Un travail technique de mise en équivalence doit donc être réalisé si l’on veut les réunir et former une base de données publique. Ce virage n’est toutefois pas impossible, comme l’ont montré les pouvoirs publics danois et slovaques, qui ont permis aux agriculteurs de rentrer leurs données en ligne sur une plate-forme gratuite gérée par l’État, sans avoir à débourser d’argent pour exploiter un logiciel privé ; cela faciliterait la collecte publique de ces informations, sans opérer de contrôle sur place, et leur traitement. Ce changement pourrait également rendre les agriculteurs sereins, avec des contrôles qui pourraient, dès lors, être plus transparents, se faisant au fil de l’eau par collecte des données numériques. En outre, depuis 2022, les données relatives aux pesticides, sont entrées dans le Régime européen spécifique pour les données d’intérêt général (RGPD, qu’on nomme « régime de l’altruisme »), ce qui pourrait également en accélérer la mise à disposition pour tous les publics concernés et enlever les feins liés à la disponibilité des données. Mais qu’en est-il des informations sur les moments et lieux précis d’épandage des pesticides ? L’information des riverains sur les épandages de pesticides Actuellement, une des populations les plus demandeuses de transparence restent les riverains, soucieux de leur santé. Si, sur le plan médiatique, les personnes qui s’inquiétent de ces questions sont souvent perçues comme des militants politiques, le père d’un enfant gravement malade, vivant dans la région de La Rochelle, où l’on soupçonne un cluster de cancers pédiatriques lié à l’épandage des pesticides, résumait ainsi son engagement initial : « On n’était pas des militants actifs, mais des parents d’élève. » Informer les riverains leur donnerait la possibilité de se protéger en partie des retombées des épandages. Mais, ici aussi, avoir des informations claires et précises à l’échelle des parcelles reste laborieux. Tenter de modifier cela, s’est d’ailleurs transformé en un feuilleton normatif et judiciaire qui dure depuis cinq ans. Certains territoires (comme le Limousin pour la pomme, et l’Isère pour la noix) avaient à l’époque commencé à mettre en œuvre des initiatives concertées d’information des riverains, par SMS ou par l’intermédiaire d’applications numériques, la veille des traitements. Mais l’obligation faite par l’État en 2019 d’utiliser des chartes réglementaires (des textes obligatoires listant les engagements des applicateurs de pesticides et rappelant les enjeux liés aux épandages), pour fournir ces informations, a provoqué une crispation des agriculteurs et un recul de pratiques initiées localement et/ou par filières. Après cela, les chartes élaborées de 2020 à 2023 n’ont exigé qu’une nécessité d’information au moment de l’épandage (souvent par allumage du gyrophare du tracteur au moment du traitement et via par exemple l’affichage des calendriers de traitements prévisibles sur les sites des chambres d’agriculture). Mais ces chartes ont été considérées comme contraires à la réglementation en janvier par le tribunal administratif d’Orléans, puis, en novembre 2024, par la cour administrative d’appel de Versailles, au motif que l’information n’est pas préalable au traitement et pas suffisamment individualisée,…