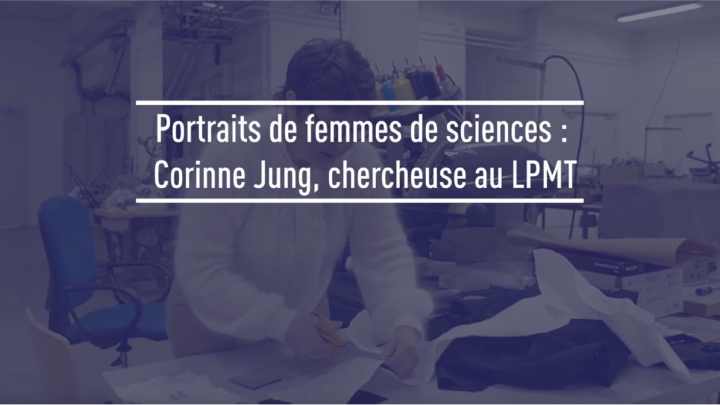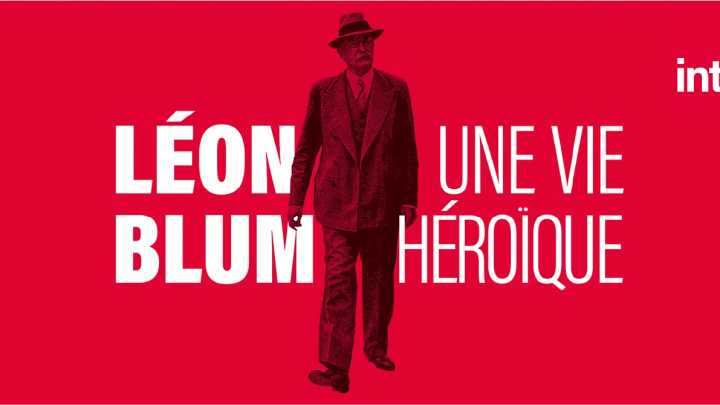Publié le 17 janvier 2024 Article aussi disponible en anglais ici Littérature : pourquoi retraduisons-nous les classiques ? Enrico Monti, Université de Haute-Alsace (UHA) Si vous parcourez les rayons d’une bibliothèque ou d’une librairie en quête des aventures de Gregor Samsa ou Jay Gatsby, vous pourrez être confrontés à un dilemme insoluble. Quelle version choisir de ces grands classiques de la littérature ? Dans une bibliothèque ou une librairie bien fournie, vous pourriez trouver jusqu’à sept traductions différentes des Métamorphoses ou de Gatsby le Magnifique. On ne parle pas ici d’éditions différentes, mais bel et bien de textes différents, de mots différents. D’ailleurs on pense – et on affirme – avoir lu Kafka ou Fitzgerald, alors que très souvent ceux qu’on a lus sont les mots de Vialatte, Lortholary, Lefebvre, Llona, Wolkenstein, Jaworski, pour ne citer que quelques traducteurs de ces deux chefs-d’œuvre de la littérature mondiale. Quelle traduction choisir, donc ? La plupart de nous se laisseront guider par les mêmes critères qui déterminent notre choix d’un classique francophone : l’affection pour une maison d’édition ou une collection, les paratextes, le prix, la couverture… Assez rarement par la renommée de ces invisibles de la littérature traduite que sont les traducteurs, acteurs silencieux d’une interprétation qu’on imagine impersonnelle et objective, et surtout pas cruciale. Et d’ailleurs, pourquoi tous ces traducteurs s’affolent-ils sur un seul et même texte ? Question légitime, compte tenu des innombrables textes qui attendent toujours leur traduction. Si la traduction a comme but primaire de rendre un texte intelligible à un public qui ne maîtrise pas la langue dans lequel il a été écrit, les retraductions sont clairement des opérations à très faible utilité. Et pourtant, très rares sont les Français qui s’approchent aujourd’hui de Dante, Cervantes ou Shakespeare dans une traduction française vieille ne serait-ce que de 100 ans, alors que les Italiens, les Espagnols et les Anglais continuent de lire leurs auteurs phares dans une langue vieille de plusieurs siècles (non sans le secours d’une pléthore de notes explicatives). Pourquoi ne cessons-nous de remettre les classiques étrangers au goût du jour ? Parce qu’un classique est un texte qu’on ne cesse jamais de retraduire, pourrait-on dire, inversant les termes de la question. Le phénomène de la retraduction est à la fois paradoxal et inhérent à toute culture. Un historien de la traduction, Michel Ballard, y a même vu une des constantes de l’histoire de la traduction, de toutes les époques. Censure, imprécisions et vieillissement des traductions Les raisons sont évidemment multiples. Le plus souvent, le moteur est un sens d’insatisfaction avec les traductions existantes, qui peut avoir des origines différentes. Des formes de censure, par exemple, idéologique ou morale, qui ont privé les lecteurs de certains aspects d’un texte. Pas besoin de dictatures pour voir le texte dépouillé de certaines références ou expurgé d’une partie de la culture qui l’a produit. Dans d’autres cas, l’insatisfaction peut être liée à la présence de fautes et imprécisions, due à la faiblesse humaine ou à des ressources lexicographiques limitées : il suffit de penser à l’écart énorme entre les conditions de travail des traducteurs pré-Internet et nous, qui sommes à un simple clic d’une vérification qui pouvait demander des journées de recherche il y a trente ans seulement. Prenons une des supposées « erreurs » les plus fameuses de l’histoire de la traduction, à savoir les cornes sur la tête du Moïse de Michel-Ange (1515). Le sculpteur s’appuie sur la traduction latine de la Bible faite par Saint-Jérôme quelque 1 100 ans auparavant (longévité sans doute inégalable pour une traduction). Or, l’hébreu, langue consonantique, se passe de l’indication de voyelles générant dans le passage en question une ambiguïté entre keren (cornu) et karan (rayonnant). Si Jérôme interprète « cornu », et avec lui une grande partie de l’iconographie chrétienne des siècles à venir, toutes les traductions contemporaines de la Bible donnent à Moïse un visage « rayonnant », lorsqu’il reçoit les tables de la loi. Pour restituer au texte son ambiguïté éventuelle, il faudra attendre la traduction « intersémiotique » de Chagall, qui trouve dans un autre système de signes – la peinture – la possibilité d’attribuer à Moïse de véritables cornes de lumière. Une des raisons les plus souvent évoquées pour retraduire est que les traductions vieillissent. Quid des originaux ? Ils vieillissent eux aussi, mais différemment, nous dira-t-on. Ils gagnent du charme, alors que le vieillissement des traductions vire souvent au grotesque. La différence est à chercher essentiellement dans les statuts respectifs d’original et traduction : texte dérivé, la traduction ne peut pas exister sans le texte primaire dont elle est émanation et ce statut secondaire lui enlève l’autorité d’un vrai texte littéraire. Il y a aussi peut-être le fait, démontré par la linguistique de corpus, que les traductions tendent à être plus conservatrices du point de vue stylistique et donc à moins charger la langue de ce sens qui fait la richesse d’un chef-d’œuvre littéraire. L’impression de vieillissement peut aussi venir d’une meilleure connaissance de la culture cible, notamment par rapport à certains éléments culturels (realia) devenus monnaie courante : une note de bas de page pour expliquer ce qu’est le pop-corn, qu’on peut encore retrouver dans certaines traductions de l’après-guerre, serait non seulement inutile, mais décidément comique aujourd’hui. Parfois les retraductions amènent des changements macroscopiques, au niveau des titres, des noms des personnages ou de certains concepts, suscitant, à tort ou à raison, des réactions exacerbées, car déstabilisantes. Si la transformation de la novlangue en néoparler dans la retraduction de 1984 a fait parler les lecteurs et les critiques, certaines tentations divines peuvent être beaucoup plus déstabilisantes, comme le montrent les réactions suscitées par la réforme de la prière du Notre Père en 2013. La retraduction peut faire scandale, de par le relativisme qu’elle introduit dans l’interprétation d’un original que nous considérons comme immuable. En réalité, parfois c’est le texte même qu’on croyait « original » qui se découvre dérivé : c’est ainsi que la retraduction de Kafka pour la Pléiade récupère une nouvelle version du texte allemand, qui n’est pas celle héritée de Max Brod à laquelle l’histoire nous a habitués. Dans quelques cas encore, la…