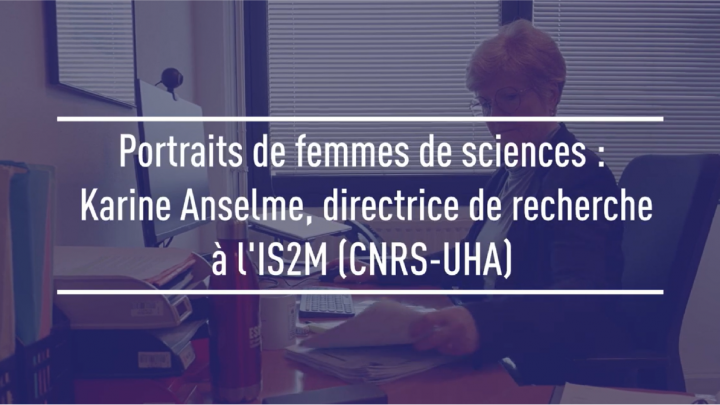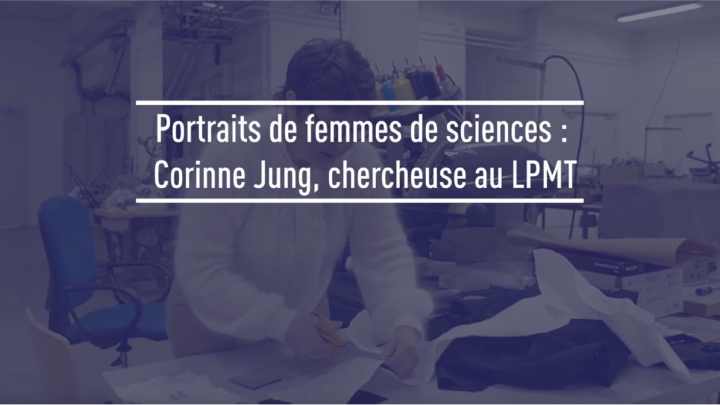Publié le 6 octobre 2024 Quand la France produisait de l’antimoine, élément stratégique méconnu Vincent Thiéry, IMT Nord Europe – Institut Mines-Télécom et Pierre-Christian Guiollard, Université de Haute-Alsace (UHA) Utilisé depuis l’Antiquité, l’antimoine est présent dans de nombreux objets de notre vie quotidienne. Alors que la Chine détient aujourd’hui le monopole de son extraction et s’apprête à limiter ses exportations, levons le voile sur un pan méconnu de l’histoire minière de la France : celle-ci fut, un temps, le premier producteur mondial d’antimoine. La récente décision de la Chine de limiter ses exportations d’antimoine, dont elle est le principal producteur mondial, repose une nouvelle fois la question de notre dépendance à ces métaux que nous n’exploitons plus sur notre territoire et que nous utilisons quotidiennement, parfois sans le savoir. Si la nouvelle ne vous a pas fait frémir, c’est sans doute que vous ignorez tout, comme la plupart des gens, de cet élément stratégique méconnu. Et pourtant, en son temps, la France fut un important producteur d’antimoine. Et même le premier producteur mondial, pendant quelques années… Mais alors, de quoi parle-t-on ? Cinquante-et-unième élément du tableau périodique, de symbole Sb, ce métalloïde (pnictogène) frappe par son nom original, dont l’étymologie est d’ailleurs controversée depuis le XVIIe siècle. La légende du moine Basile Valentin qui, voyant que ce minerai était bon pour les cochons, aurait empoisonné ses condisciples en leur en faisant ingérer a la vie dure… Mais le terme pourrait plutôt venir de l’arabe atemed ou encore du grec anti-monos, signifiant que cet élément est rarement seul dans la nature, puisqu’on le trouve essentiellement sous forme de sulfures ou d’oxydes. Vomitif, purgatif et fard à paupières L’usage de antimoine date de l’Antiquité. Dans le pourtour méditerranéen, on l’utilisait traditionnellement comme fard à paupières, nommé « khôl ». Son incorporation dans les objets d’art est également attestée par l’étude d’un fragment de vase de Tello en Chaldée (actuellement Girsu, Irak) par le chimiste Marcelin Berthelot (1886). Par ailleurs, la médecine intègre l’antimoine à différentes préparations depuis des temps immémoriaux. Les banquets romains de l’antiquité l’utilisaient déjà comme vomitif au cours des banquets. Louis XIV fut guéri du typhus à 20 ans, sur les conseils de Mazarin, par un émétique (vomitif) à base d’antimoine – ironie du sort, ce même Mazarin mourut intoxiqué par des préparations médicales antimoniées… Les vertus purgatives de l’antimoine, tant comme vomitif que purgatif, ont donné lieu à un usage fréquent de cet élément dans différentes préparations. Telles que les « pilules perpétuelles » destinées à être ingurgitées puis éliminées par les voies naturelles pour être réutilisées après nettoyage. De nos jours, l’antimoine est par exemple utilisé dans le traitement de la leishmaniose, maladie chronique parasitaire provoquant des affections cutanées ou viscérales. Mais on retrouve aussi l’antimoine comme retardateur de flamme dans les matériaux combustibles (textiles, caoutchoucs synthétiques, peintures, plastiques de pare-chocs…). De l’imprimerie aux shrapnels On le retrouve également dans de nombreux alliages métalliques. Après l’invention par Gutenberg de l’imprimerie moderne vers 1454, il prend son essor comme durcisseur du plomb dans les caractères d’imprimerie, où sa teneur atteint jusqu’à 30 % – en France, Le Démocrate, dans l’Aisne, est le dernier journal imprimé au plomb typographique. La teneur en antimoine dans les alliages à base de plomb varie de 5 à 6 % (batteries) à plus de 10 % (tôles, câbles, plombs de chasse). Son usage important dans des obus à balles (« Schrapnels », ou projectiles à fragmentation) au cours de la Première Guerre mondiale contribua à l’essor de son exploitation et à son caractère stratégique. Sous forme de pentasulfure, on le retrouve aussi comme lubrifiant dans les parties mobiles des automobiles. Certains semi-conducteurs, également, en incorporent. En chimie, enfin, les sulfures d’antimoine vulcanisent le caoutchouc, ce qui le colore en rouge. Il joue aussi un rôle de catalyseur dans la fabrication des polyéthylènes téréphtalates (PET). Enfin, le tartrate de potassium et d’antimoine (« tartre émétique ») est un pesticide utilisé dans le traitement des agrumes. Pour finir, l’aspect blanchissant de l’oxyde d’antimoine est mis à profit depuis longtemps dans les peintures. Les plus grands gisements sont aujourd’hui en Chine Tout comme la majorité des ressources minérales, l’antimoine est réparti de manière inégale à la surface terrestre. Sa teneur moyenne est de l’ordre de 0,2 ppm à l’échelle de la croûte continentale, avec des variations notables entre par exemple certains basaltes qui en contiennent environ 10 ppm, alors que la majorité des autres roches en présentent des concentrations de l’ordre du ppm. Ainsi, différents processus géologiques (hydrothermalisme, magmatisme…) ont conduit à sa reconcentration en des sites bien spécifiques, en particulier sous forme de filons. À l’échelle mondiale, les gisements les plus importants sont situés en Chine, notamment au sein de la province du Hunan. La ville de Xikuangshan, où se situe la mine du même nom, est connue comme « capitale mondiale de l’antimoine ». Les réserves s’y chiffrent en centaines de milliers de tonnes d’antimoine métal. Notons parmi les autres pays exploitant encore l’antimoine de nos jours, la Bolivie et la Russie. La France, l’autre pays de l’antimoine De par sa riche géologie, la France fut aussi un important producteur d’antimoine, et même le premier mondial (30 à 50 % de la production planétaire) entre 1888 et 1914 grâce aux gisements corses de 1888 à 1898 puis au gisement de La Lucette entre 1899 et 1914. Parmi les zones productrices, le district de Brioude-Massiac en Auvergne, au sein duquel les Romains extrayaient déjà du plomb et de l’argent, fut également majeur pour l’antimoine. Un texte historique nous le décrit ainsi : « Ces mines sont situées dans le plus affreux pays de la haute Auvergne […] le chemin qui conduit à Mercoyre (aujourd’hui Mercœur, NDLR), est si rude et si difficile, qu’il n’y a que les mulets du pays qui puissent y passer, encore faut-il plus de dix heures pour y arriver. On sent de loin l’odeur de soufre qui s’exhale des fours où on fait fondre la mine d’antimoine, et les feuilles des broussailles qui sont aux environs en paraissent endommagées. » À proximité de Massiac (15), l’ancienne mine d’Ouche détient à…