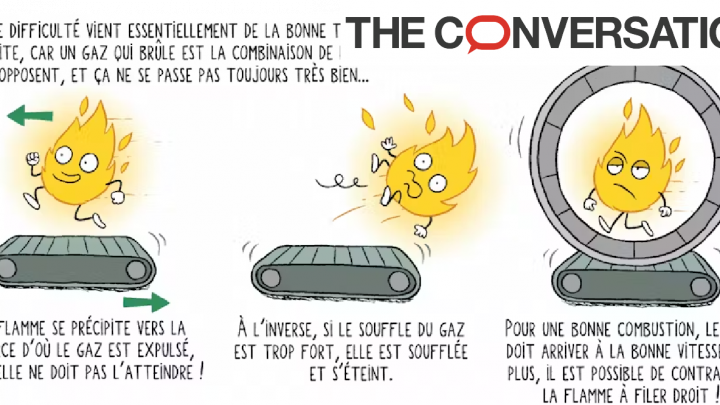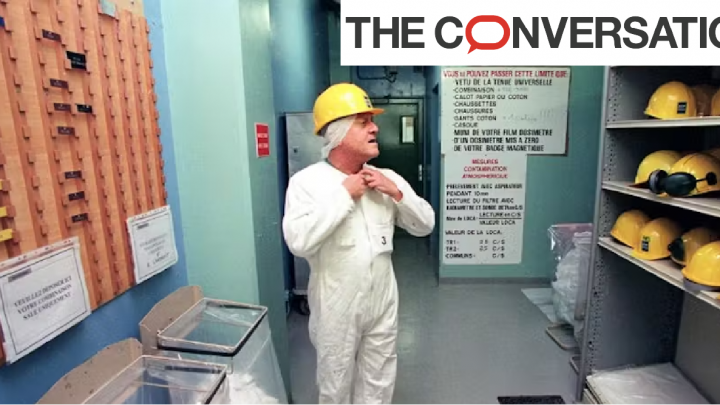Le mouvement anti-Amazon de retour avec la crise de la Covid-19
Publié le 16 novembre 2020 Le mouvement anti-Amazon de retour avec la crise de la Covid-19 Hanene Oueslati, Université de Haute-Alsace (UHA) Depuis l’annonce du deuxième confinement et de la décision de fermeture des commerces jugés non essentiels, nous assistons à une vague de contestations plaçant le géant du e-commerce Amazon dans le viseur des responsables politiques, des enseignes de distribution et des consommateurs. Amazon, en particulier, devient le responsable des maux de cette société fragilisée par la crise sanitaire de la Covid-19. Cela prend plusieurs formes allant de l’appel à boycott d’Amazon par des politiciens, des associations consuméristes et des enseignes de la grande distribution, jusqu’à la création d’un plugin « Amazon Killer » recommandé aux consommateurs afin de chercher un livre sur Amazon et de l’acheter dans une librairie physique, ou de « Amazon Antidote » qui guide le consommateur vers d’autres sites proposant le même produit vendu par Amazon, à des prix plus bas. L’ampleur de la tendance de boycott d’Amazon en France est jugée sans précédent. Cédric O, Secrétaire d’État chargé de la transition numérique, l’assimile à « une psychose française sur Amazon qui n’a pas beaucoup de sens ». Il précise que « Amazon, c’est 20 % du e-commerce en France », représentant le pourcentage le plus faible dans les pays de l’Union européenne. Pour cela, deux questions se posent : pourquoi s’attaque-t-on à Amazon en particulier, malgré le fait qu’il ne soit pas seul sur le marché du e-commerce français ? Et pourquoi ce mouvement anti-Amazon est-il propre à ce deuxième confinement ? Pour répondre à ces questions, une étude qualitative, qui paraîtra en 2021, a été menée auprès de commerçants appartenant aux deux catégories : « commerces essentiels » et « commerces non essentiels » et de consultants en matière de RSE (responsabilité sociale des entreprises). Une étude ethnographique complémentaire a permis d’analyser une centaine de réactions clients à différentes publications écrites ou vidéo en relation avec l’appel au boycott d’Amazon. Cela nous a permis d’identifier les facteurs explicatifs du mouvement de boycott d’Amazon lié au deuxième confinement, ainsi que les limites de ce mouvement. L’injustice cultivée par Amazon… Selon la théorie de la justice sociale de Rawls (1971), l’homme juste est celui qui soutient les organisations justes. Or, Amazon incarne pour certaines personnes interviewées l’image du capitalisme sauvage caractérisé par un engraissement qui ne profite qu’à un très petit nombre de bénéficiaires. Ainsi, il a été pendant plusieurs années attaqué pour ses valeurs sociales et sociétales. Il a souvent fait l’objet de mouvements de contestation à l’égard de sa politique sociale caractérisée par des conditions de travail jugées inhumaines, par une politique salariale injuste, par la suppression de postes et la robotisation de ses entrepôts, etc. Covid-19 : l’inquiétude des salariés d’Amazon. De plus, Amazon a été pointé du doigt, à plusieurs reprises, à cause d’une mauvaise protection de ses salariés lors de la première vague de la Covid-19, en refusant de fermer ses entrepôts malgré les nombreux cas atteints signalés. Ses salariés se sont retrouvés dépourvus de moyens de protection, seuls face à la pandémie, contribuant ainsi, injustement, à l’enrichissement du géant du e-commerce. En France, on reproche à Amazon, l’opacité des informations au niveau de son chiffre d’affaires de la publicité en ligne, des places de marché et du cloud. Ces chiffres estimés à plus de 50 % du chiffre d’affaires total réalisé en France, ne sont pas taxés. Ainsi, Amazon ne contribue pas à l’économie française grâce aux avantages fiscaux dont il jouit, contrairement à d’autres géants du Web français tel que C-discount, dont les richesses générées profitent à l’économie française, et de manière indirecte aux Français. Amazon est perçu comme un opportuniste qui a énormément profité de la guerre contre la Covid-19, à travers la montée fulgurante de son chiffre d’affaires et de ses cours d’action en bourse. Les quelques initiatives du géant du e-commerce de mettre en avant les produits fabriqués en France et de soutenir les entreprises françaises sur son site Web, sont assimilées à de « la poudre de perlimpinpin ». Amazon est considéré, par certains, comme l’un des « riches de la guerre » avec tout ce que cela porte comme symboles négatifs d’opportunisme, d’égoïsme, d’individualisme et d’injustice. Les attentes de solidarité avec les Français, d’assistance aux petits commerçants et d’aide aux salariés non remplies par Amazon lors de la première vague ont contribué à ternir son image et à faire de lui une cible privilégiée lors de cette deuxième vague de la Covid-19. L’injustice cultivée par les politiciens et relayée par les médias… L’appel au boycott d’Amazon par madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, a fait l’effet de « la seringue hypodermique » sur certains consommateurs qui ont placé le géant du e-commerce dans l’agenda de leurs sujets de discussion. Ce discours a d’autant plus été considéré comme faisant appel au sentiment de culpabilité du consommateur et à son sens de la justice, tel qu’évoqué par le philosophe américain John Rawls (1971). Cela a été accentué par les communiqués des différentes fédérations du commerce, les publicités « solidaires » diffusées par certaines enseignes de distribution, ainsi que les discours politiques contradictoires au sujet d’Amazon. Or, au lieu d’aider à rétablir la justice sociale chez les Français, la médiatisation des différents discours politiques a davantage creusé le sentiment d’injustice sociale chez eux ; elle leur a donné l’impression qu’Amazon est plus fort que l’État français. Certains commerçants se lamentent en rappelant que : « lutter contre Amazon quand on fait partie du gouvernement doit se traduire par des lois et non pas par l’appel au boycott… ». Par ailleurs, lors du deuxième confinement, l’interdiction d’ouvrir les commerces jugés non essentiels, y compris les rayons concernés chez les supermarchés et les hypermarchés français, à l’exception des e-commerçants dont Amazon, a davantage éveillé le sentiment d’injustice sociale chez les consommateurs et les commerçants français. Cela a pris la forme de deux grandes polémiques. La première polémique concerne la catégorisation de ce qui est essentiel de ce qui ne l’est pas. La hiérarchie des biens retenue par le gouvernement ne reflète pas de manière juste et équitable celle des commerçants français qui trouvent que les…