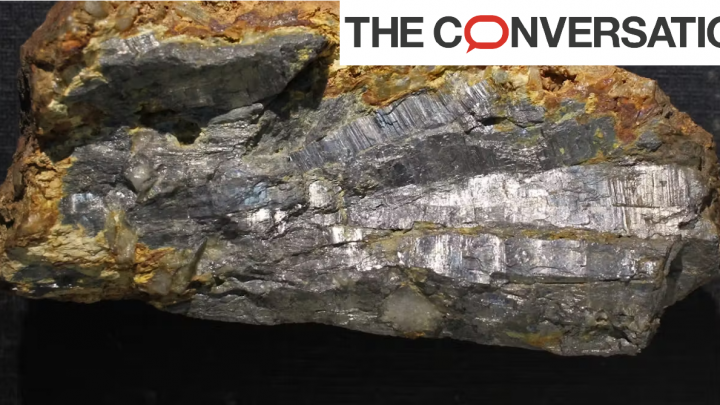L’anthropocène, un objet frontière qui signifie plus qu’une tranche de temps géologique
Publié le 28 octobre 2024 L’anthropocène, un objet frontière qui signifie plus qu’une tranche de temps géologique Luc Aquilina, Université de Rennes 1 – Université de Rennes; Catherine Jeandel, Centre national de la recherche scientifique (CNRS); Clément Poirier, Université de Caen Normandie; Clément Roques, Université de Neuchâtel; Jacques Grinevald, Graduate Institute – Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID); Jan Zalasiewicz, University of Leicester; Jérôme Gaillardet, Institut de physique du globe de Paris (IPGP); Martin J. Head, Brock University; Michel Magny, Université Marie et Louis Pasteur (UMLP); Nathanaël Wallenhorst, Université de Haute-Alsace (UHA) et Simon Turner, UCL Même si le groupe de travail de la Commission internationale de stratigraphie a refusé la proposition de créer une nouvelle période géologique nommée anthropocène, le débat n’est pas clos pour autant. Le concept reste précieux pour décrire notre époque, et permet de fédérer des communautés scientifiques distinctes. Les géologues découpent l’histoire de la Terre en « tranches de temps » chronologiques qu’on appelle la « chronostratigraphie ». Depuis 20 ans, l’observation de l’impact des activités humaines sur le système Terre a conduit à penser que nous étions entrés dans une nouvelle époque géologique : l’anthropocène. La définition de cette dernière a fait l’objet d’un groupe de travail créé au sein de la Commission internationale de stratigraphie (CIS), l’instance qui décide de la chronologie géologique. La proposition du groupe de travail de créer une nouvelle époque à partir de 1952 a été refusée par la CIS le 5 mars 2024. Nous ne reprendrons pas ici le détail des arguments techniques sur lesquels se base ce refus. Ils ont été contrés un à un, par le groupe de travail sur l’anthropocène, puis par des chercheurs extérieurs – et cela à plusieurs reprises. Notre question est : le débat est-il clos ? La réponse que viennent d’apporter plus de 50 scientifiques dans la revue Nature est : non ! Un concept qui fédère les différentes communautés scientifiques Au-delà de la communauté stratigraphique, le concept d’anthropocène est reconnu par plusieurs communautés. Il est couramment repris par l’ensemble des scientifiques qui travaillent sur le « système Terre » (géologues, climatologues, hydrologues, écologues, pédologues…). Il est devenu un cadre très utilisé par les sciences humaines et sociales. Plus largement, le concept a dépassé la sphère des scientifiques pour se répandre dans les médias, le langage politique et territorial. C’est, enfin, un puissant ressort artistique. Surtout, pour ces nombreuses communautés, l’anthropocène est devenu un concept capital, agrégateur de sciences éloignées les unes des autres. C’est devenu une matrice pour penser le monde de façon renouvelée et pour envisager de nouvelles méthodes de faire de la science, de l’art et des politiques publiques. Malgré la décision de la CIS, l’anthropocène continuera donc à vivre au sein de ces communautés. Des périodes régulièrement redéfinies Les unités de temps chronostratigraphiques (notamment les périodes subdivisées en époques) ont fait l’objet de nombreuses discussions par le passé. Récemment, les limites du Quaternaire ou de l’Holocène, nos périodes et époques actuelles, ont été modifiées sans que les unités en elles-mêmes soient remises en question. Ce sont des caractéristiques relativement homogènes qui vont déterminer ces unités de temps géologique. Pour les temps très anciens, à l’échelle de la centaine de millions d’années, ces caractéristiques sont connues à un niveau de détail relativement faible. Plus on s’approche de notre présent, plus on dispose de données : ces unités de temps deviennent beaucoup plus courtes. Elles sont également caractérisées par des paramètres plus précis. Ainsi l’Holocène – la période actuelle – se définit, entre autres, par une gamme étroite de températures et de compositions de l’atmosphère et de l’océan. Or, depuis la révolution industrielle et surtout depuis l’après-guerre, les températures, tout comme la composition de l’atmosphère, ont varié de façon extrêmement rapide. Nous sommes sortis des gammes de variation habituelles de ces paramètres durant l’Holocène, comme le montre la partie tout à droite sur le graphe ci-dessous. Au-delà de ces seuls marqueurs, les activités humaines sont à l’origine de l’apparition de nombreux polluants. Les plastiques, par exemple,ont fini par s’incorporer dans les sédiments qui se déposent au fond des lacs et des océans depuis quelques dizaines d’années. Les tests nucléaires ont augmenté la concentration d’éléments radioactifs dans l’atmosphère et dans l’enregistrement sédimentaire. Ce sont ces marqueurs radioactifs qui ont conduit à faire débuter l’anthropocène en 1952, l’année de la première explosion aérienne d’une bombe à hydrogène. Avant la proposition du groupe de travail à la CIS, la question de la date de début de l’anthropocène avait déjà fait l’objet de débats et de plusieurs propositions. En effet, on peut retracer les influences des activités humaines plus loin en arrière. Quand Paul Crutzen, prix Nobel de chimie a proposé l’idée d’anthropocène en 2000, il estimait que cette nouvelle époque pouvait être datée au début de l’industrialisation liée à l’utilisation du charbon, à la fin du XVIIIᵉ siècle. Si le groupe de travail sur l’anthropocène n’a pas retenu ces dates, c’est qu’il s’est attaché à caractériser le moment où les activités humaines ont fortement, dramatiquement et, pour partie, irrémédiablement transformé les conditions de l’habitabilité de notre planète. L’anthropocène comme point de bascule Les dates précédemment évoquées sont des signes avant-coureurs d’une croissance exponentielle de notre impact, dont on retrouve les traces indubitables dans notre environnement et les enregistrements géologiques après la Seconde Guerre mondiale. Quel que soit le paramètre envisagé (composition de l’atmosphère, températures, cycle du carbone, impacts sur la biodiversité, modifications du cycle de l’eau, explosion de la production alimentaire et du tourisme, développement de la consommation de biens matériels…) l’évolution montre une rupture majeure à partir des années 1950, et des taux de progression actuels que rien ne semble pouvoir enrayer. Depuis 2007, on décrit ce demi-siècle comme celui de la « Grande Accélération ». En quelques dizaines d’années, les variations ont largement dépassé les fluctuations des derniers millénaires et plus encore, celles de toute l’époque de l’Holocène, qui a début il y a plus de 10 000 ans. Nombre de travaux scientifiques l’ont montré, ces progressions nous entraînent vers des conditions non durables. Nous sortons d’un contexte bioclimatique favorable à la vie humaine…