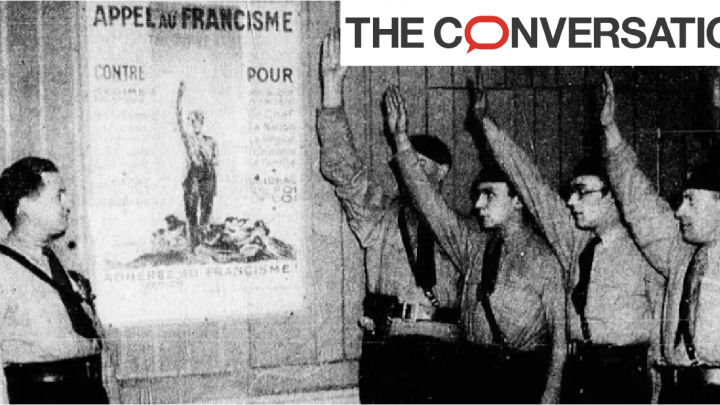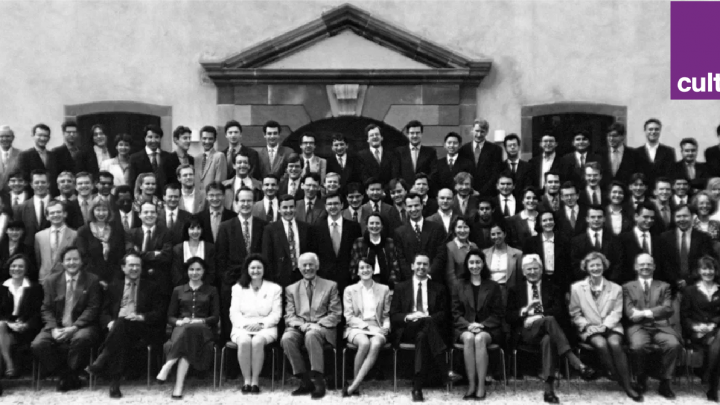Bonnes feuilles : « La grande résurrection du business de la mort »
Publié le 2 février 2022 Bonnes feuilles : « La grande résurrection du business de la mort » Faouzi Bensebaa, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières et Fabien Eymas, Université de Haute-Alsace (UHA) Comment un marché ankylosé en 1992 est-il devenu particulièrement dynamique en 2022 ? La mort serait-elle devenue tendance ? Ou est-ce dû à l’ingéniosité de nombreux acteurs qui, surfant sur les évolutions culturelles, législatives et technologiques, sont parvenus à presque faire « aimer » le trépas ? Ces acteurs, ce sont non seulement les pompes funèbres bien sûr, interlocuteurs inévitables des familles et de l’entourage du défunt, mais également les innombrables start-up qui cherchent à disrupter un à un les différents marchés mortuaires, comme Grantwill qui veut être le « premier réseau social post mortem », ou encore Testamento qui attaque les notaires avec son offre de testaments olographes sécurisés. Ce sont ces acteurs, leurs offres et leur manière d’opérer que Faouzi Bensebaa et Fabien Eymas analysent dans leur livre Le business de la mort (Éditions L’Harmattan), dont nous vous proposons ici les bonnes feuilles… Des marchés (dé)réglementés La dynamisation du marché de la mort débute notamment avec la promulgation de la loi Sueur qui a sonné le glas du monopole communal sur les pompes funèbres. Cela a entraîné le développement d’un petit nombre d’acteurs privés qui, profitant de la structure oligopolistique du marché, ont pu faire croître les prix et augmenter ainsi leur chiffre d’affaires. Néanmoins, le marché des pompes funèbres et, de manière plus générale, les marchés liés à la mort apparaissent encore réglementés. Lorsqu’une personne décède, il est nécessaire de respecter la temporalité précisée par les textes de loi. Par exemple, le constat du décès doit être réalisé par un médecin sous 24h et la crémation ou l’inhumation doit intervenir dans une fourchette située entre 48h après le décès au plus tôt et 6 jours au plus tard. La réglementation joue également un rôle dans le développement de marchés liés à la mort. En la matière, la France apparaît frileuse et sa réglementation empêche – à tort ou à raison – le développement de marchés comme celui de la cryogénisation, de la dispersion des cendres ou du suicide assisté. En imposant la dispersion de l’ensemble des cendres du défunt au même endroit, la législation française réduit la possibilité, pour les familles, de recourir à certaines prestations créatives qui se développent à l’étranger. Pourtant, le développement de la crémation – 1 % des décès en 1980 contre près de 40 % aujourd’hui – accroît la demande potentielle de différenciation dans la dispersion des cendres. S’il est envisageable, en France, de faire disperser ses cendres en pleine nature (forêt, mer, etc.), leur transformation en diamant, leur envoi dans l’espace lointain ou le dépôt d’une partie d’entre elles dans un godemichet comme le propose un designer néerlandais n’apparaissent pas possibles. Faut-il le regretter ? Concernant le sujet plus sensible du suicide assisté, une législation à contre-courant permet à un pays, en l’occurrence la Suisse, de bénéficier d’un avantage concurrentiel vis-à-vis du reste du monde. Concrètement, ce marché ne pouvant exister qu’en Suisse, ce pays attire de nombreux ressortissants européens non suisses désirant mettre fin à leur jour, faisant de la Confédération helvétique la destination phare du « tourisme de la mort ». Même en matière d’obsèques animales, tout n’est pas possible. Si les bêtes de 40 kg au plus peuvent être inhumées sur la propriété familiale, c’est dans une fosse d’une profondeur d’au moins 1 mètre et à une distance de 35 mètres au minimum des habitations et des points d’eau. Mais les inhumations dans des cimetières pour animaux – celui d’Asnières-sur-Seine (92) date de 1899 ! – et, surtout, les crémations ont le vent en poupe. Aux États-Unis, ce sont plus de 500 000 animaux par an qui ont droit à des funérailles ! Une ubérisation en cours ? À défaut de pouvoir se lancer sur des marchés juridiquement inaccessibles, les start-up françaises attaquent les entreprises traditionnelles des pompes funèbres et… les notaires ! Les premières, accusées de pratiquer des prix opaques – et donc forcément abusifs – doivent faire face à l’émergence de pompes funèbres en ligne qui proposent des prestations comparables tout en promettant des prix cassés. Paradoxalement, l’arrivée de ces entreprises numériques dans les années 2010 n’a pas empêché – tant s’en faut – l’inflation des prix pratiqués par les pompes funèbres traditionnelles. Certainement profitent-elles ou ont-elles profité de la faible attirance de leurs clients – des personnes âgées en moyenne de 60 à 70 ans – pour le commerce en ligne. Certainement un simple répit qui appelle une évolution en profondeur d’acteurs qui bénéficient de la situation d’urgence à laquelle sont confrontées les familles. Un autre exemple de tentative d’ubérisation d’acteurs historiques est celui de la start-up Testamento s’attaquant au monopole de fait des notaires sur le marché des testaments. Mais, à y regarder de plus près, il nous semble qu’il ne s’agit pas d’une attaque frontale, mais bien plutôt d’une proposition complémentaire qui ne devrait pas – pour l’instant en tout cas – mettre les notaires en difficulté. En effet, il existe trois types de testaments : olographe, authentique et mystique. Le premier est rédigé et conservé par le testateur lui-même, alors que les deux autres nécessitent l’intervention d’un notaire : pour la rédaction et la conservation dans le cas du testament authentique et simplement pour la conservation dans le cas du testament mystique. Bien entendu, il est beaucoup plus difficile de contester un testament authentique qu’un testament olographe. C’est là qu’intervient Testamento qui, en fournissant des modèles, propose de sécuriser la rédaction d’un testament olographe. Il apparaît ainsi que, pour l’heure, Testamento cherche davantage à exploiter une pratique hors marché – la rédaction d’un testament olographe – qu’à concurrencer les notaires sur leur marché ô combien captif des testaments authentiques. Mais les marchés relatifs à la mort ne sont pas simplement affectés par une digitalisation que l’on retrouve dans la plupart des secteurs, les technologies les plus modernes sont aussi mobilisées afin de découvrir la clé de l’éternité et de ressusciter les morts. La technologie pour ne pas mourir… La quête de l’éternité…