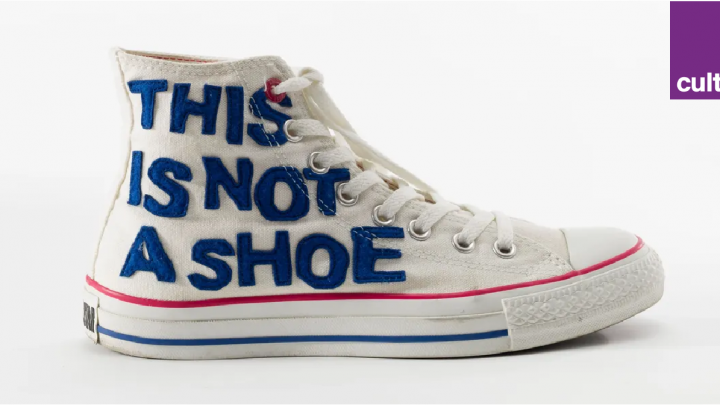Les universités françaises dans la tourmente budgétaire
Publié le 24 octobre 2023 Les universités françaises dans la tourmente budgétaire Marc Bollecker, Université de Haute-Alsace (UHA) Lors de la rentrée 2023, le président de l’Université de Strasbourg et de l’Udice (association qui regroupe 10 établissements), Michel Deneken, alertait sur les difficultés budgétaires dans pratiquement toutes les universités, qui « seront toutes en déficit d’ici un ou deux ans ». Plusieurs facteurs cumulatifs expliquent ces difficultés, qui ne sont certes pas nouvelles. Ils relèvent principalement de décisions de politiques publiques qui ont des impacts sur le budget des établissements. Or, ces difficultés risquent de s’aggraver en raison des 904 millions d’euros de coupes budgétaires annoncés début mars 2024 par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. De plus en plus d’étudiants Ces dernières années, le choix d’élever le niveau de qualification de la population (pour stimuler la croissance économique et consolider l’emploi) s’est traduit par l’objectif de porter à 50 % d’une classe d’âge le taux de diplômés de l’enseignement supérieur. Les universités françaises accueillent ainsi de plus en plus d’étudiants : 1 660 000 environ pour l’année universitaire 2022-2023, soit 271 000 supplémentaires en 10 ans. Cette augmentation conséquente des effectifs a engendré de nombreux coûts additionnels pour les établissements (augmentation du nombre d’heures de cours, d’intervenants, de salles, de la consommation de chauffage, etc.). La loi relative aux libertés et responsabilités des universités (2007) a particulièrement impacté le budget des universités. Elle a consisté à poursuivre le mouvement de décentralisation engagé par l’État en transférant la gestion de la masse salariale (soit 60 à 70 % du budget jusqu’alors centralisé) aux établissements. Cette évolution vers davantage d’autonomie a conduit à une responsabilité accrue de chaque université, qui gère désormais une masse de coûts (fonctionnement, personnel, investissement) correspondant à l’ensemble de son activité. Si une dotation annuelle de l’État (devenue « Subvention pour charge de service public », ou SCSP) équivalente aux montants transférés a accompagné cette autonomisation, elle s’est érodée au fil des années si on la rapporte au nombre d’étudiants. L’augmentation des salaires des personnels fonctionnaires, inhérente à leur ancienneté et à leur progression de carrière, n’a été que partiellement (voire pas du tout) compensée par l’État, tout comme l’augmentation du point d’indice décidée en 2022. Le poids du parc immobilier Parmi les facteurs majeurs de tensions budgétaires, les coûts actuels et à venir de l’entretien du parc immobilier pèsent également lourdement sur la situation financière. Une étude de la Cour des comptes en 2022 sur l’immobilier universitaire révèle que 34 % des surfaces sont dans un état peu ou pas satisfaisant ; 9 % des établissements recevant du public ont reçu un avis défavorable de la commission de sécurité locale. Le coût de réhabilitation du patrimoine universitaire avoisinerait les 7 milliards d’euros (15 milliards pour France Universités, organisation qui rassemble les dirigeants des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche), dont les trois quarts seraient en rapport avec la transition énergétique. Certes, l’État ou les collectivités territoriales interviennent (notamment au travers des dispositifs comme les Contrats de plan État-Région ou les Programmes d’investissements d’avenir). Cependant, les établissements doivent prendre en charge l’entretien du patrimoine (qui présente désormais le deuxième poste de dépenses après la masse salariale) ainsi que les fluides (gaz, électricité, eau) qui alourdissent les comptes dans un contexte de forte inflation. Par ailleurs, l’internationalisation de l’enseignement supérieur et de la recherche a connu une forte accélération à partir des années 1990. Au-delà de la traditionnelle mobilité internationale des étudiants et des enseignants, encouragée notamment par le processus de Bologne en 1998, l’internationalisation des programmes de formation ainsi que la création de consortiums ou alliances internationales se sont considérablement intensifiées. Si ces alliances bénéficient de financements conséquents de la part de l’Union européenne, l’internationalisation requiert des financements élevés, de l’ordre de plusieurs centaines de millions d’euros. Le recrutement de personnels complémentaires est également devenu indispensable pour déployer le management de la qualité et le contrôle dans les universités. La loi de programme pour la recherche de 2006 a officiellement lancé le management de la qualité dans les universités par la création de l’agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES, devenue le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, ou HCÉRES). Il s’inscrit dans un mouvement plus global de labellisation et de certifications (label Développement durable et Responsabilité sociétale ; label européen Human Resources Strategy for Researchers, etc.). Des moyens humains et des coûts additionnels ont là encore été nécessaires, tout comme pour la mise en œuvre des obligations légales prévues par la loi sur l’autonomie des universités de 2007 ou encore par le décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique en 2012. New Public Management Ces tensions budgétaires récurrentes ont conduit à la multiplication de rapports et travaux de recherche : beaucoup font le constat d’une inadéquation des financements actuels compte tenu des défis que les universités publiques françaises ont à relever. Si les financements complémentaires récents prévus dans le cadre de la loi Orientation et Réussite (2018) de la loi de Programmation de la Recherche (2020) ou des pôles universitaires d’innovation (prévus dans le cadre du plan « France 2030 ») viennent soutenir les activités des universités, ils s’inscrivent dans un temps limité. Si les montants engagés par l’État depuis 2010 dans le cadre des Programmes d’investissement d’avenir sont conséquents, ils ont créé une forte différenciation entre les établissements en capacité de répondre aux appels à projet et les autres. Dans certains cas, ils sont en effet conditionnés aux regroupements entre les universités (Pôles de recherche et d’enseignement supérieur, communautés d’universités et établissements, établissement public expérimental) et à leur maintien. Plusieurs pistes sont évoquées pour transformer le financement des universités. Dans un rapport de 2019, le sénateur Philippe Adnot propose que les établissements développent leurs ressources propres pour limiter leur dépendance à l’État : une augmentation raisonnée des frais d’inscription des étudiants français et étrangers, le développement de la formation pour adultes et de l’alternance, la création de nouvelles fondations universitaires, la valorisation du patrimoine immobilier. Comme d’autres, il préconise la mise en place de contrats d’objectifs,…