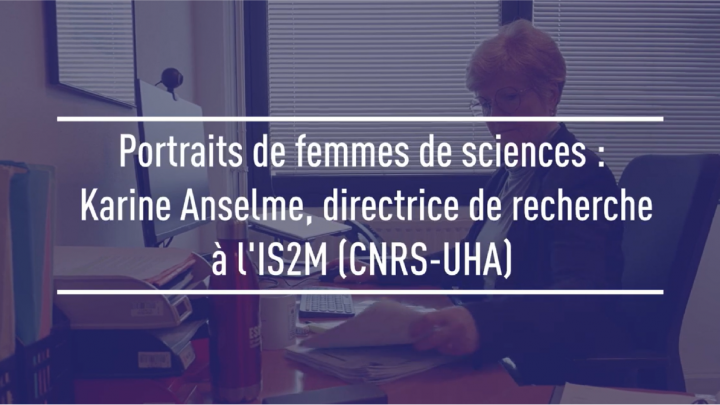Publié le 11 juillet 2024 La démocratie libérale suppose un monde partagé Renaud Meltz, Université de Haute-Alsace (UHA) La séquence politique qui s’est ouverte avec la dissolution de l’Assemblée nationale le 9 juin a fait surgir une crainte : que, pour la première fois depuis 1940, la France rompe avec la démocratie libérale. La campagne électorale de ces dernières semaines a également donné lieu à plusieurs commentaires sur un retour aux années 1930, comme si l’histoire était cyclique et que la démocratie libérale devait périodiquement être remise en question par un autre modèle. Or la dynamique des populismes en France, comme à l’échelle mondiale, illustre cette lutte séculaire entre la démocratie libérale et l’autoritarisme. Elle manifeste que l’empire sans limite du libéralisme dans toutes les sphères d’activité des citoyens peut trahir l’espoir d’égalité politique mais aussi économique et sociale de la démocratie, et engendre une revanche de la démocratie illibérale – un jeu ancien, dont les années 1930 n’ont été qu’un moment parmi d’autres. « Les années 1930 sont devant nous ! » « Les années 1930 sont devant nous ! » En novembre 1990, Gérard Granel, philosophe injustement oublié, héritier improbable de Marx et Heidegger, joue l’oiseau de mauvais augure avec cette prophétie à contretemps du triomphalisme occidental. France Culture, l’histoire de la « fin de l’histoire ». Un an plus tôt, Francis Fukuyama a publié La fin de l’histoire (Flammarion, 1992 pour l’édition française), essai dans lequel il constate la victoire du libéralisme occidental, économique et politique. Après la chute de l’URSS, loin de se répandre comme un modèle unique, la démocratie libérale a bientôt révélé ses contradictions internes. Granel l’a compris d’emblée : ce triomphe masque une nouvelle « lame de fond populiste ». Le philosophe ne prédit pas le retour des années 1930, mais le soubresaut d’un processus historique commencé depuis plusieurs siècles. L’avènement d’une démocratie sans libertés ? Le totalitarisme des années 1930 avait le visage de l’immixtion de l’État dans toutes les sphères de la société, caractéristique du nazisme des années 1930. Quel visage prendra le prochain « renversement du système démocratique et libéral » ? En philosophe plutôt qu’en historien, Granel prévoit que le libéralisme sans la démocratie est préparé par la mobilisation totale de la société au service de la production de richesse. L’économie mondialisée a tout digéré, le politique comme la sphère culturelle ou toute autre activité humaine non productive de richesse. La liberté sans la démocratie prépare-t-elle une démocratie sans libertés ? Granel était loin d’être le seul à dénoncer le capitalisme sans entrave au seuil des années 1990. L’année où il prononce sa conférence, le film Pretty Woman sort sur les écrans. Cette fable autour du mythe de Pygmalion fit la célébrité mondiale de Julia Roberts et trouva une audience évidemment sans commune mesure avec la prophétie de Granel. Bande annonce du film Pretty Woman, 1990. L’intrigue amoureuse entre la prostituée et l’homme d’affaires s’entremêle à un autre fil narratif, qui peut, à mon sens, apparaître comme un propos discrètement politique. Faut-il continuer à délocaliser l’industrie américaine pour augmenter le profit des financiers ? Film hollywoodien, Pretty Woman se termine par un double happy-end : le loup de Wall Street renonce à dépecer un chantier naval américain ; il préfère le recapitaliser pour maintenir l’activité sur le sol national. Cette dénonciation vertueuse de la recherche sans fin du profit est promue par l’industrie des loisirs mondialisés. Cette ruse de l’histoire, vicieuse, n’avait pas de quoi surprendre Granel. On sait ce qu’il en a été de la dynamique sans limite de la recherche de profit, ce libéralisme sourd à la démocratie : les ouvriers, las d’être une variable négligeable dans la course au profit, ont voté pour le protectionnisme de Donald Trump et fragilisé leurs propres libertés individuelles. La démocratie libérale, rare jeu d’équilibre entre libertés individuelles et politiques Revenons au fondement du projet politique moderne. On se souvient parfois confusément d’une lutte entre les forces révolutionnaires et contre-révolutionnaires qui ont ponctué notre modernité politique, comme une série de couples. Pensons à la Grande révolution (de 1789) et la Restauration (1814-1830) ; les Trois glorieuses (juillet 1830) et le libéralisme conservateur de François Guizot. Celui-ci était à la fois théoricien du libéralisme, hostile à la souveraineté populaire et à la démocratie sous la monarchie de Juillet. Enfin, février puis juin 1848 et l’Ordre moral ; jusqu’à la lutte entre monarchistes et républicains sur les décombres du Second Empire, qui voient la victoire des seconds, bientôt contestée par les Boulangistes ou les socialistes. La « démocratie » au XIXᵉ, une réalité plus sociale ou juridique La « démocratie » désigne pour les hommes du début du XIXe siècle une réalité plus sociale ou juridique que politique : les droits fondamentaux accordés à tous, qui brisent la société d’ordre, bien plus que le suffrage universel, alors décrié par les libéraux. Alors, les républicains, qui admettent la démocratie politique et le suffrage universel, s’inspirent du modèle de l’antiquité grecque : un projet collectif qui transcende les intérêts particuliers. Il est juste d’imposer aux individus un bien commun, quitte à négliger les intérêts de la minorité. Face à eux, les libéraux attendent du gouvernement l’ordre et la stabilité qui permet aux individus de poursuivre librement leurs intérêts particuliers. Loin de souhaiter la démocratie, ils vouent aux gémonies la tyrannie de la majorité, la démagogie du grand nombre. La démocratie, pouvoir confié au peuple, qui arroge à la majorité le pouvoir de contraindre la liberté de la minorité, et le libéralisme qui vise l’autonomie de l’individu, n’étaient pas voués à se marier. Les libéraux comme Guizot luttaient en théorie comme en pratique contre la tyrannie de la démocratie, la démagogie du pouvoir confié à la masse. De fait, le projet démocratique, au temps des démocraties populaires, dans le bloc soviétique, a fait fi des libertés individuelles. Aussi bien d’un point de vue historique, la « démocratie libérale » a longtemps été un oxymore. C’est une chimère rare qui se crée à l’orée du XXe siècle : la démocratie libérale. On oublie que l’Europe continentale n’en connaît que deux, alors : la France et la Suisse. Le reflux illibéral de nos fameuses années 1930 referme une parenthèse très courte favorable à la démocratie libérale, née…