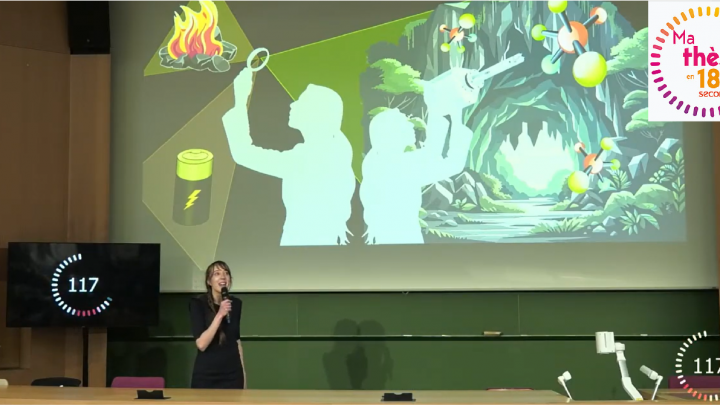Éditer le génome pour soigner : où en sont les thérapies issues de CRISPR et ses dérivés ?
Publié le 7 janvier 2026 Éditer le génome pour soigner : où en sont les thérapies issues de CRISPR et ses dérivés ? Carole Arnold, Université de Haute-Alsace (UHA) Nous assistons à une nette montée des espoirs pour des maladies rares, souvent « orphelines ». Par exemple, un nourrisson atteint d’un déficit métabolique rare (une maladie génétique dans laquelle une enzyme ou une voie métabolique essentielle ne fonctionne pas correctement) dû à une mutation sur le gène CPS1, a reçu en 2025 un traitement « sur mesure » utilisant la technique d’édition de base (base editing), avec des résultats biologiques encourageants. Aujourd’hui, l’édition génique n’est plus une hypothèse lointaine, mais donne des résultats concrets et change déjà la vie de certains patients. Pour comprendre ce qui est en train de se jouer, il faut revenir sur les progrès fulgurants de ces dernières années, des premiers essais pionniers aux versions de plus en plus sophistiquées de l’édition génomique. Développée en 2012 grâce à l’association d’une endonucléase, Cas9, et de petits ARN guides (sgRNA), cette méthode d’édition ciblée du génome a bouleversé la biologie moderne, au point de valoir à ses inventrices le prix Nobel de chimie en 2020. Depuis son invention, le CRISPR-Cas9 classique est largement utilisé dans les laboratoires, dont le nôtre, pour créer des modèles cellulaires de maladies, fabriquer des cellules qui s’illuminent sous certaines conditions ou réagissent à des signaux précis, et explorer le rôle de gènes jusqu’ici mystérieux. Un premier système extraordinaire mais imparfait Côté clinique, l’utilisation de CRISPR-Cas9 a ouvert des possibilités thérapeutiques inédites : modifier précisément un gène, l’inactiver ou en corriger une version défectueuse, le tout avec une simplicité et une rapidité jusqu’alors inimaginables. Mais cette puissance s’accompagnait alors de limites importantes : une précision parfois imparfaite, avec des coupures hors-cible difficiles à anticiper (des modifications accidentelles de l’ADN réalisées à des endroits non prévus du génome), une efficacité variable selon les cellules, et l’impossibilité d’effectuer des modifications plus fines sans induire de cassure double brin (une rupture affectant les deux brins d’ADN à un site génomique spécifique) potentiellement délétère. Ces limites tiennent en grande partie au recours obligatoire aux cassures double brin et à la réparation par homologie (mode de réparation de l’ADN dans lequel la cellule s’aide d’une séquence d’ADN modèle très similaire – ou fournie par le chercheur – pour réparer une cassure double brin), un mécanisme peu fiable et inégal selon les types cellulaires. Mais la véritable rupture est apparue à partir de 2016 avec l’invention des éditeurs de base (base editors), des versions ingénieusement modifiées de CRISPR capables de changer une seule lettre de l’ADN sans provoquer de cassure double brin. Pour la première fois, il devenait possible de réécrire le génome avec une précision quasi chirurgicale, ouvrant la voie à des corrections plus sûres et plus fines que celles permises par Cas9 classique. Cependant, les base editors restaient limités : ils permettaient d’effectuer certaines substitutions de bases, mais étaient incapables de réaliser des insertions ou des modifications plus complexes du génome. Ces limitations des base editors ont été en partie levées avec l’arrivée de leurs successeurs, les prime editors, en 2019 : ces nouvelles machines moléculaires permettent non seulement de substituer des bases, mais aussi d’insérer ou de supprimer de courtes séquences (jusqu’à plusieurs kilobases), le tout sans provoquer de cassure double brin, offrant ainsi un contrôle beaucoup plus fin sur le génome. Cette technique a été utilisée avec succès pour créer en laboratoire des modèles cellulaires et animaux de maladies génétiques, et des plantes transgéniques. Cependant, en pratique, son efficacité restait trop faible pour des traitements humains, et le résultat dépendait du système de réparation de la cellule, souvent inactif ou aléatoire. Mais en six ans, la technique a gagné en précision et polyvalence, et les études chez l’animal ont confirmé à la fois son efficacité et la réduction des effets hors-cible. Résultat : en 2025, six ans après son invention, le prime editing fait enfin son entrée en clinique, un moment que beaucoup de médecins décrivent comme un véritable tournant pour la médecine. Des traitements sur le marché Dès 2019, de premiers essais cliniques avec le système CRISPR-Cas9 classique (le médicament Casgevy) avaient été réalisés sur des patients atteints de β-thalassémie et drépanocytose, deux maladies génétiques de l’hémoglobine, via la correction ex vivo et la réinjection des cellules modifiées au patient. Les premiers résultats étaient prometteurs : certains patients avaient vu leur production de globules rouges anormaux corrigée de manière durable, avec une amélioration significative de leurs symptômes, après une unique injection. Le traitement Casgevy a d’ailleurs été approuvé en Europe en 2024, pour un coût d’environ 2 millions d’euros par patient. Plus récemment, en 2025 un bébé atteint d’une mutation du gène CPS1 a été guéri grâce à l’édition de base, la version moins invasive et plus sûre de CRISPR-Cas9, mais qui reste limitée aux substitutions ponctuelles et ne permet pas toutes les modifications (pas d’insertion de séquences longues). Mais aujourd’hui, le prime editing lève les deux grands verrous du CRISPR-Cas9 classique – la nécessité de casser l’ADN et la dépendance à des mécanismes de réparation inefficaces – ouvrant la voie à une édition plus sûre, plus précise et applicable à un spectre beaucoup plus large de maladies. Il n’est plus limité à de simples conversions ponctuelles, mais permet pour la première fois de remplacer ou restaurer un gène complet, de façon précise et contrôlée. L’année 2025 marque le premier succès clinique d’une telle thérapie – une étape historique pour l’édition génomique. En effet, le 19 mai 2025 la société Prime Medicine fondée par David Liu, inventeur du prime editing, a annoncé la première administration humaine de sa thérapie, destinée à un jeune patient atteint de granulomatose chronique, une maladie immunitaire rare liée à une mutation de l’ADN. Les premiers résultats biologiques de ce « CRISPR ultrapuissant » se sont révélés très prometteurs, ouvrant une nouvelle ère pour l’édition génomique. Il faudra toutefois patienter encore quelques mois avant de mesurer réellement le succès du prime editing : les premiers essais cliniques restent très récents et le manque de…