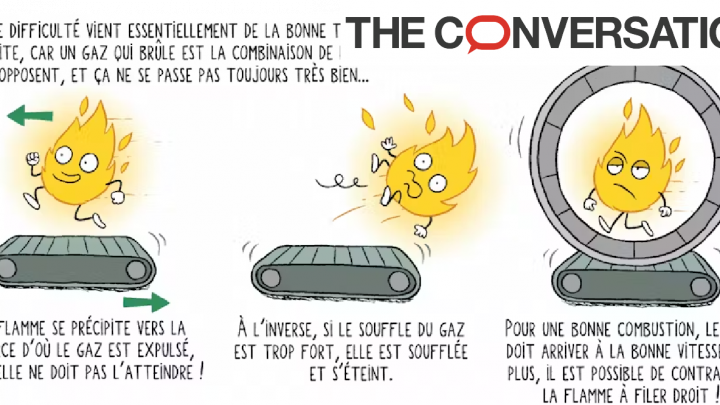Veolia-Suez : la réussite de l’acquisition dépendra aussi des mécanismes de contrôle mis en place
Publié le 12 octobre 2020 Veolia-Suez : la réussite de l’acquisition dépendra aussi des mécanismes de contrôle mis en place Marc Bollecker, Université de Haute-Alsace (UHA) et Marion Hertzog, Université de Haute-Alsace (UHA) L’actualité des opérations de fusions-acquisitions en France est particulièrement marquée par l’offensive de Veolia, acteur majeur de la gestion de l’eau et des déchets, sur son concurrent Suez. En effet, le lundi 5 octobre 2020, le groupe Engie a décidé de céder à Veolia près de 30 % des parts qu’il détient de son concurrent dans un contexte particulièrement polémique, dans lequel la présidence de la République est même accusée d’être intervenue dans le vote (ce que l’Élysée dément). Le 9 octobre, le tribunal judiciaire de Paris a d’ailleurs décidé de suspendre l’opération « tant que les comités sociaux et économiques concernés n’auront pas été informés et consultés quant aux décisions déjà prises ». Les deux entreprises ont annoncé qu’elles feraient appel de cette décision. Au-delà de ce cas, ce type d’opérations fait régulièrement l’objet d’une forte médiatisation : General Electric – Alstom, Fiat Chrysler – PSA, Vivendi – Havas, Siemens – Alstom, etc. Régulièrement, elles conduisent même à l’intervention des plus hautes autorités de l’État, comme l’a encore montré le dossier Veolia-Suez. Cette médiatisation s’explique par les craintes que suscitent les fusions-acquisitions, qui sont loin d’être spécifiques au secteur de l’eau et de la valorisation des déchets. Peur de l’échec Les craintes se cristallisent le plus souvent autour des difficultés d’une situation post-fusion ingérable, de pertes d’emplois, de position monopolistique, d’offre publique d’achat (OPA) future (ici sur Suez), et des incertitudes sur la rentabilité des sommes décaissées (estimées à près de 3,4 milliards d’euros dans le cas de Veolia). Ces craintes s’expliquent également par les risques d’échecs des opérations de fusion-acquisition qui demeurent élevés. Les différentes études menées sur ces opérations s’accordent sur un taux d’échec approchant les 70 %. Relevons cependant que ce qui est entendu par la performance de ces opérations varie considérablement selon les interlocuteurs. Par exemple, en finance, elle peut se mesurer par la création de valeur pour les actionnaires (rentabilité, croissance du chiffre d’affaires, économie d’échelles) ou par l’abandon des opérations. En gestion des ressources humaines, ce peut être l’impact sur les licenciements ou sur le climat social ; en stratégie, la réalisation des objectifs stratégiques tels que le développement régional. Si des intérêts stratégiques conduisent les groupes à maintenir de telles opérations, malgré des résultats financiers souvent décevants, il est particulièrement utile de s’intéresser aux facteurs postérieurs aux opérations de fusion-acquisition, explicatifs de leurs échecs ou de leurs succès. Choisir son dispositif d’intégration De nombreux travaux de recherche ont été menés sur la question. Sans être exhaustif, certains montrent le rôle des dirigeants et du leadership, d’autres se focalisent sur la gestion des différences culturelles, les relations humaines et l’identité, d’autres encore sur la gestion de l’incertitude et de l’ambiguïté, ou la vitesse d’intégration. Quel que soit l’angle d’analyse adopté, ces opérations nécessitent d’intégrer, dans une nouvelle entité, des structures et collaborateurs présentant des différences cognitive, sociale, géographique voire institutionnelle plus ou moins importantes. En réalité, il s’agit d’un problème classique et ancien dans toutes les organisations, d’intégration et de différenciation. Les dispositifs d’intégration (ou mécanismes de contrôle) se traduisent par des systèmes, des règles, des pratiques et des valeurs qui orientent les comportements des collaborateurs vers la réalisation des objectifs et de la stratégie de l’organisation. Les chercheurs en contrôle de gestion, Teemu Malmi et David Brown, ont montré la diversité de tels dispositifs d’intégration massivement utilisés par les firmes : plans d’action à court, moyen et long terme (planification), budgets, indicateurs financiers et non financiers, tableaux de bord (contrôle cybernétique), récompenses et bonus, délégations des responsabilités, procédures, gouvernance (contrôles administratifs), valeurs, croyances, normes sociales (contrôles culturels) etc. La grande majorité des fusions-acquisitions sont des échecs (Frédéric Fréry, Xerfi Canal, 2016). Dans le cas d’une fusion-acquisition, ces dispositifs d’intégration peuvent s’avérer tout à fait utiles pour sensibiliser les employés aux finalités de l’opération, pour véhiculer les objectifs de la nouvelle entité, voire même pour les rassurer quant à leur avenir (à supposer que cela soit envisageable !). Dans ce type d’opération, le groupe acquéreur est alors amené à réaliser un choix complexe sur le degré et les mécanismes de contrôle (intégration) des différentes entités et sur leur autonomie (différenciation) respective. Ce choix peut prendre trois formes différentes si l’on se réfère à l’une des nombreuses typologies réalisées sur le sujet : la préservation, l’absorption, la symbiose. La première forme se traduit par la conservation de l’identité et de l’autonomie de chaque entité, la coordination se limitant à un contrôle financier (par exemple LVMH et Liberty Surf). Elle se retrouve souvent dans des stratégies de diversification menées par le groupe acquéreur. La deuxième se caractérise par une faible autonomie de l’entité acquise et une très forte coordination par l’acquéreur. Elle passe le plus souvent par la recombinaison des ressources et de l’identité de la structure acquise (par exemple Axa et UAP). La dernière forme d’intégration implique le maintien de l’autonomie tout en développant des relations de coordination approfondies sur le plan opérationnel par des mutualisations des processus (par exemple Air France et KLM). Intégrer de manière optimale Dès lors, parmi les différents facteurs de réussite d’une opération de fusion-acquisition, on peut relever l’importance d’une recherche de cohérence entre les dispositifs d’intégration (ou mécanismes de contrôle organisationnel) existants ou à développer dans chacune des entités et la forme d’intégration choisie. On peut ainsi aisément comprendre que, dans le cas d’une intégration qui vise la préservation des spécificités de l’entité acquise, l’utilisation massive par l’acquéreur d’une variété de dispositifs d’intégration (contrôle culturel, contrôle administratif, contrôle cybernétique, planification…) s’avère peu pertinente. Elle conduit à une mise sous contrôle excessive ou inadaptée des employés. Elle expose l’acquéreur au rejet des dispositifs d’intégration. Nombreux sont les travaux ayant démontré des risques de controverses, de non-appropriation voire de rejet, même au-delà des opérations de fusion-acquisition. Inversement, la seule utilisation d’outils de contrôle cybernétique dans une forme fusionnelle ne serait pas suffisante pour assurer…