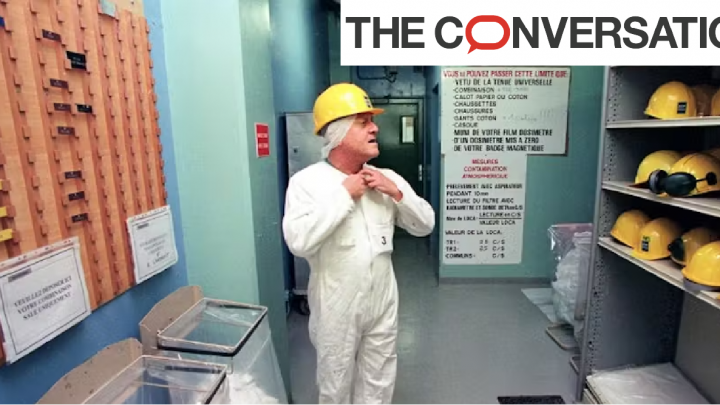Quel avenir pour les territoires du nucléaire en France ?
Publié le 2 mai 2017 Quel avenir pour les territoires du nucléaire en France ? Teva Meyer, Université de Haute-Alsace (UHA) Le premier réacteur de la centrale de Fessenheim (Haut-Rhin) sera arrêté samedi 22 février et le second fin juin, a confirmé ce mercredi un décret. Il annonce la fermeture définitive et totale de la centrale nucléaire la plus ancienne en France. Cette décision replace au centre du débat l’avenir des territoires du nucléaire. Les futurs gouvernements français ne pourront échapper à la nécessité de fermer certaines centrales, même s’ils décidaient de les remplacer par d’autres plus modernes. Les réacteurs nucléaires ne sont en aucun cas éternels et le remplacement de certains de leurs composants les plus importants, usés par le temps, apparaît tant techniquement difficile que peu rentable. L’expérience de Fessenheim et du mouvement d’opposition qui s’était constitué autour de l’association Fessenheim Notre Énergie dès l’annonce de sa fermeture doit servir d’avertissement. L’avenir des communes accueillant des réacteurs ne doit pas être exclusivement pensé en termes économiques. Car loin de ne représenter que des pôles d’emplois interchangeables, les centrales nucléaires ont structuré, en près d’un demi-siècle d’existence, l’identité et les liens sociaux quotidiens de leur territoire d’implantation. Il est alors fondamental d’anticiper leur transformation identitaire et sociale, au risque de répéter (à une moindre échelle) les crises qui ont frappé les régions charbonnières du nord de la France après la fermeture des mines. Des « pays perdus » redynamisés par le nucléaire À l’inverse de l’Allemagne où les centrales ont été construites à proximité immédiate de grandes agglomérations ou dans des campagnes densément peuplées, le programme nucléaire français s’est déployé dans des territoires ruraux en déprises démographiques et économiques. Pour ces « pays perdus », selon l’expression de l’ethnologue Françoise Lafaye, l’arrivée du nucléaire symbolisait l’intégration dans un projet d’envergure qui les plaçait au cœur de la reconstruction de la nation après la guerre. En présentant les réacteurs tantôt comme de nouveaux châteaux le long de la Loire, tantôt comme des cathédrales des temps modernes, le gouvernement français inscrivait ces communes dans une continuité glorieuse du récit national, comme l’a bien décrit l’historienne américaine Gabrielle Hecht dans son ouvrage The Radiance of France. L’installation des travailleurs du nucléaire accompagnés de leur famille a renversé le dépeuplement des campagnes sélectionnées. À titre d’exemple, la population de Fessenheim a augmenté de 120 % entre le début des travaux de la centrale en 1970 et sa mise en service sept ans plus tard. Fidèle à ses habitudes d’aménagement du territoire et de gestion de son personnel, Électricité de France (EDF) a construit des lotissements dans quelques villages autour des centrales, favorisant ainsi la concentration des agents. Celle-ci ne s’est pas faite sans frictions avec les habitants locaux qui ne voyaient pas toujours positivement l’arrivée d’une nouvelle population aux habitudes différentes, logées dans des quartiers souvent entièrement séparés du bâti historique que le géographe Louis Chabert appelait les « colonies nucléaires ». L’arrivée « des EDF » a également modifié la sociologie de ces territoires. D’extraction urbaine et diplômés, les agents de la centrale bénéficient d’un pouvoir d’achat plus élevé que les locaux. Selon l’Insee, les rémunérations des employés des centrales dépassent de près de 50 % le salaire net moyen en France ; et près de 90 % d’entre eux bénéficient de contrats à durée indéterminée. Alors que le nucléaire a permis la sauvegarde de ces territoires, il n’est pas étonnant de voir l’industrie atomique s’immiscer jusque dans les blasons des communes, tels que Braud-et-Saint-Louis (33) et Paluel (76), où bien sur les logos des communautés de communes comme celles de l’Essor du Rhin, où se trouve Fessenheim, et de Cattenom. Pour les élus locaux, les centrales sont alors associées au maintien de la population dans les campagnes et leur fermeture est perçue comme le risque d’une disparition démographique. Un apport financier sans commune mesure En permettant la construction de nouvelles routes et la mise en place de système d’adduction d’eau, les chantiers des réacteurs ont amélioré le quotidien de ces territoires. Ce sont toutefois les recettes des taxes foncière et professionnelle (remplacée en 2012 par l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau sans baisse substantielle de revenus) qui ont entraîné les transformations les plus flagrantes. Particularité du droit français, l’assiette de ces deux taxes est calculée pour les usines sur la base du coût des bâtiments et des machines utilisées. Ceux-ci étant particulièrement onéreux pour un réacteur nucléaire, dont la Cour des comptes a estimé la valeur à 800 millions d’euros, le montant des taxes dues par les centrales est astronomique. L’analyse des budgets des communes est sans appel. Ainsi, les recettes de fonctionnement de la celle de Paluel étaient en 2015 de 5 765 euros par habitant contre seulement 787 euros en moyenne dans les communes françaises démographiquement identiques. Après avoir permis l’embellissement des rues, des mairies et des bâtiments historiques, cette manne a servi à financer, au gré des choix des élus locaux, des infrastructures de loisirs inhabituelles pour de petites communes rurales : piscines, bibliothèque, médiathèques, gymnase, salle de concert, etc. Exemple parmi d’autres, Saint-Vulbas, où se trouve la centrale du Bugey, jouit ainsi d’un palais des congrès ainsi que d’un centre aquatique pour un peu plus de mille habitants. En permettant le développement de ces lieux, le nucléaire a structuré les temps de loisirs et les liens sociaux dans ses territoires d’implantation. Une industrie omniprésente au quotidien Les recettes fiscales du nucléaire ont également permis aux territoires hôtes de mettre en place des services de grande qualité : raccordement des habitants à la fibre optique à Chooz, acquisition d’un chalet dans les Hautes-Pyrénées pour Braud-et-Saint-Louis, centre de dialyse à Belleville-sur-Loire, festival de musique d’envergure internationale à Avoine, la liste est longue. Ces services sont orchestrés par des centres communaux d’action sociale (CCAS) profitant de subventions municipales dix fois plus importantes en moyenne que le reste des communes françaises. L’argent permet également aux écoles d’offrir des prestations autrement inaccessibles. À Fessenheim, où était installée la famille de Victor Schoelcher, père de l’abolition de l’esclavage, les écoliers profitent ainsi d’un échange scolaire avec la…